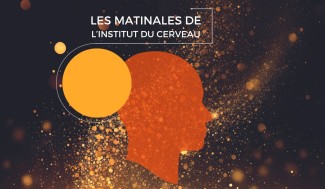Le 30 mai 2022 se tient la journée mondiale de la sclérose en plaques (SEP), l’occasion de revenir sur les enjeux de la recherche sur cette maladie.
Maladie auto-immune du système nerveux central, la Sclérose en Plaques (SEP) touche aujourd’hui plus de 100 000 personnes en France, dont 75% de femmes. Véritable enjeu de santé publique, cette maladie invalidante a des conséquences profondes sur le quotidien des patientes et des patients autant que des proches.
« Quand une maladie comme ça arrive dans une famille, c’est un bouleversement, ce sont des interrogations, beaucoup d’incompréhensions, beaucoup d’inquiétudes et beaucoup d’angoisse. Les choses changent en permanence »
D’importants progrès ont déjà été faits, avec notamment l’amélioration du diagnostic et la prise en charge thérapeutique plus précoce des patients. Un des enjeux majeurs est aujourd’hui de prévenir et de limiter le handicap chez les patients résistants aux traitements.
La recherche sur la sclérose en plaques à l’Institut du Cerveau
À l’Institut du Cerveau, les équipes de recherche tentent de mieux comprendre les capacités intrinsèques de chaque patient à réparer ses lésions et de décrypter les mécanismes de la maladie grâce à des techniques de pointe, avec pour objectif final une meilleure prise en charge des patientes et patients et le développement de nouvelles stratégies thérapeutiques.
Zoom sur trois champs d’études prometteurs explorés à l’Institut du Cerveau.
1- Révéler l’invisible : cartographier les conséquences de la sclérose en plaques
Le diagnostic de la sclérose en plaques repose actuellement sur la visualisation des lésions grâce à l’imagerie par résonnance magnétique (IRM). Aujourd’hui, les IRM utilisées en pratique clinique ne permettent que de confirmer la présence des plaques de démyélinisation. L’équipe « La remyélinisation dans la sclérose en plaques : de la biologie à la translation clinique », dirigée par Bruno Stankoff et Catherine Lubetzki, développe de nouveaux outils d’imagerie fondés sur la combinaison de l’IRM et de la tomographie par émission de positrons (TEP) afin de mieux comprendre les mécanismes biologiques qui conduisent à la dégénérescence des neurones et à l’installation du handicap chez les malades.
2 – Au cœur de la neuroinflammation : modélisation d’un univers complexe
L’équipe « Plasticité et régénération de la myéline », co-dirigé par Violetta Zujovic, s’intéresse au profil immunitaire des patients, et cherche à déterminer ce qui différencie sur ce plan ceux qui présentent une meilleure capacité de remyélinisation que les autres. Elle a notamment montré que chez les patientes et patients « bons remyélinisateurs », les lymphocytes T envoient des signaux pour placer les cellules immunitaires résidentes du système nerveux – les cellules microgliales – dans un état propice à la réparation. Ces signaux ont plus précisément pour effet de recruter au niveau de la lésion des cellules souches précurseurs, qui se différencient en cellules myélinisantes et reconstitue alors la gaine de myéline le long des axones. Dans le cas de patients à faible capacité de remyélinisation, les lymphocytes T ne permettent pas une activation appropriée de la microglie, affectant l’ensemble de la cascade de réparation.
Ces travaux ouvrent des pistes de recherche prometteuses pour l’identification de nouvelles cibles thérapeutiques dans la sclérose en plaques ainsi que pour des stratégies de modélisation plus adaptées à l’étude des réseaux biologiques complexes sous-tendant des processus pathologiques.
3- Stratégie de remyélinisation et de neuroprotection : de la cellule à la clinique
Aujourd’hui, face à l’efficacité insuffisante des traitements immunomodulateurs ou immunosuppresseurs sur l’installation d’un handicap irréversible, la recherche s’oriente sur la possibilité de prévenir l’atteinte irréversible des neurones par la stimulation de la remyélinisation. Les études réalisées à l’Institut du Cerveau sur des cultures de cellules (in vitro) ont permis d’identifier et de comprendre de façon fine et précise les mécanismes biologiques et les cellules impliqués dans la formation et la Modélisation du réseau protéines sécrétées par les macrophages des patients atteints de sclérose en plaques.
Plus d’informations sur ces projets dans notre dossier de presse (PDF).